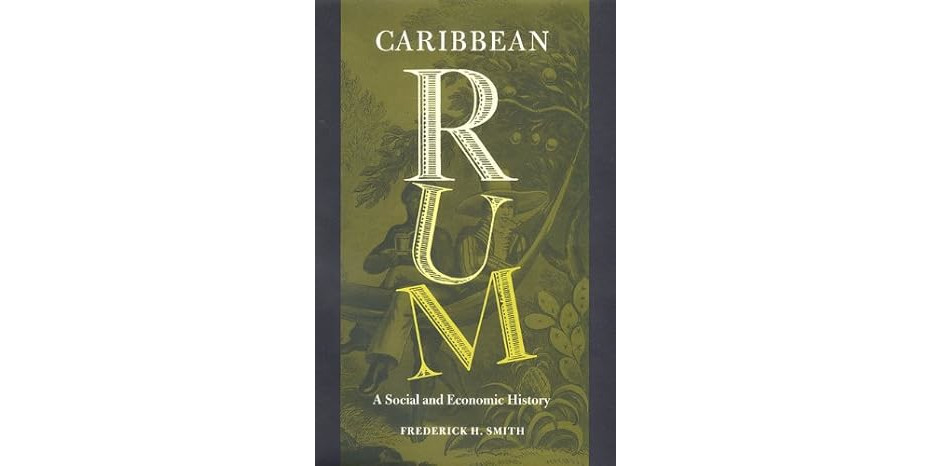Les populations d’esclaves n’ont pas été importées dans la Caraïbe pour la production de rhum, elles l’ont été pour la production agricole en générale, de tabac, de cacao, et surtout de sucre. Le rhum est un produit dérivé de la production de sucre, il est aussi un produit dérivé des sociétés esclavagistes.
Du coup il est intéressant de se poser la question historique des rapports des esclaves eux-mêmes au rhum. C’est, évidemment, une histoire complexe et je ne pose ici que quelques cailloux sur le chemin, en m’appuyant en particulier sur le travail de l’anthropologue Frederick H. Smith (Caribbean Rum, A Social and Economic History, University Press of Florida, 2005).
La consommation d’alcool, d’abord, n’était pas inconnue des populations en Afrique même, en particulier le vin de palme et la bière faite à partir de grains fermentés, puis à partir du moment où le commerce avec les européens s’engage, l’alcool importé d’Europe. Nombre de marchands européens des 16e et 17e siècles notent à la fois la consommation de brandy, en particulier, et sa position dans l’échelle sociale : ce produit importé est privilégié par les classes supérieures des sociétés africaines. Assez naturellement, à partir du moment où la production démarre dans la Caraïbe dans la seconde moitié du 17e siècle, le rhum est utilisé dans les échanges avec l’Afrique. À partir de ce moment les Africains réduits en esclavage non seulement ont une connaissance préalable de l’alcool, mais ils peuvent avoir déjà une expérience du rhum. Ce n’est pas vrai au même degré dans toutes les régions, mais par exemple dans les régions de l’Angola ou du Gold Coast, le rhum est présent aux 17e et 18e siècle. Il est par exemple intégré dans les festivals religieux et culturels, et des études d’histoire anthropologique de la religion Akan (Ghana et est de la Côte d’Ivoire) ont montré qu’il était utilisé pour faire le lien entre monde physique et monde spirituel, au même titre que d’autres stratégies comme le jeûne, la privation de sommeil, ou pour des libations lors de cérémonies aux ancêtres, aux esprits, lors de funérailles.
Quand bien même les esclaves n’auraient pas été familiers de cette boisson avant leur réduction en esclavage, il est certain qu’ils y sont immédiatement introduits dans les sociétés esclavagistes. Le Dr Collins, planteur et médecin à Saint Vincent, l’utilise dès le débarquement du bateau pour « adapter » ses esclaves à leur nouvelle situation. Le père Labat en Martinique recommande aux planteurs de réserver 10 % de leur production pour la distribuer aux esclaves. D’après les livres de comptes de la plantation Halse Hall (Jamaïque), chaque esclave recevait une ration annuelle de 25 à 40 litres de rhum. C’est sans compter la quantité que les esclaves pouvaient produire ou se procurer par ailleurs de façon plus autonome. La consommation de rhum est donc encouragée par les propriétaires, dans des proportions qui, aujourd’hui, semblent tout à fait énormes. Au point qu’il est certain que l’alcoolisme était un problème majeur parmi les populations d’esclaves. Une corrélation nette, si ce n’est une causalité, a été établie entre la production de rhum d’une île et le taux de croissance de la population d’esclaves non importés, c’est-à-dire nés localement. Plus l’île produit de rhum, plus la croissance de la population locale est fragile, voire négative.
L’encouragement à la consommation de rhum par les planteurs entre dans le contexte d’un contrôle de la société plus général. C’est dans cette logique par exemple que des rations supplémentaires ou des autorisations de consommation plus larges peuvent être autorisées au moment de certaines fêtes : à Noël et à Pâques en particulier. On est dans la même logique que Carnaval : ponctuellement, un renversement ou au moins une suspension des hiérarchies sociales est autorisé, qui légitime leur renforcement le reste de l’année. C’est une soupape de sécurité. La difficulté, pour ceux qui contrôlent et bénéficient de cette société, est de s’assurer que ça ne dégénère pas. Ça vaut pour les soldats et les marins qui sont sur ces îles, et sont aussi consommateurs de quantités astronomiques d’alcool : ça finit régulièrement en bagarres, voire en émeutes générales qui poussent de temps à autre les autorités à établir des couvre-feux. Les tavernes ferment à 20 h à la Barbade en 1656, à 21 h à Curaçao en 1715, etc. Comme quoi, les fermetures de bars et autres couvre-feux ne sont pas des nouveautés récentes. Si les risques de débordements existent pour les marins, ils sont craints bien plus encore par les blancs de la région pour les populations d’esclaves.
Et de fait il y a bien, parfois, des liens entre rhum et révoltes. L’ivresse, d’une certaine façon, est une fuite, et « vole » le planteur d’une capacité de travail. Elle est donc régulièrement et sévèrement punie : sur la plantation de Pierre Dessalles en Martinique en 1823, l’esclave Césaire reçoit 30 coups de fouet pour ivresse. En 1816 à la Barbade, une révolte d’esclaves démarre pendant les fêtes de Pâques, et une autre démarre pendant les fêtes de Noël à la Jamaïque en 1831. Très souvent, le rhum joue un rôle dans ces révoltes. Par sa consommation en général, mais aussi par son rôle symbolique, en particulier dans les serments, dans la lignée de traditions bien attestées en Afrique parmi les Igbos ou les Akans. Lors d’une révolte à Antigua en 1736 les participants se lient par un serment accompagné de la consommation d’une boisson de rhum, mélangé de poussière prise sur la tombe d’esclaves et de sang de coq. À la Jamaïque en 1769, la boisson du serment est faite de rhum, de terre prise sur une tombe, de poudre à canon et de sang.
La consommation de rhum par les populations d’esclaves montre toute la complexité de l’histoire caribéenne. Les esclaves en sont victimes, mais ils l’insèrent aussi dans une histoire qui leur est propre. C’est une histoire qui s’impose à eux, mais dont ils sont aussi les acteurs.